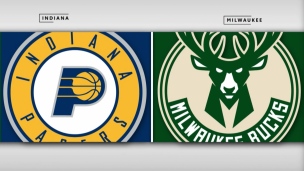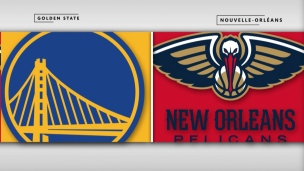L'écoanxiété, ça existe !
En forme dimanche, 19 sept. 2021. 19:25 jeudi, 14 nov. 2024. 15:17
Il y a des matins où je me lève avec une angoisse oppressante. Je pense à mes trois enfants, âgé de un, trois et cinq ans, dont le but premier dans la vie est de pouvoir engloutir une deuxième part de gâteau.
Je pense à eux, qui vont grandir dans un monde dans lequel on ne nous annonce rien qui vaille. Ai-je besoin de vous rappeler les faits, scientifiquement prouvés, et plus qu’alarmants : nous vivons sur une planète qui s’effondre, tant sur le plan climatique que sur celui de la biodiversité.
Les experts nous le rappellent depuis plus de trois décennies. D’un côté, les gaz à effet de serre que nous émettons engendrent un réchauffement climatique dont la rapidité n’a pas de précédent historique et qui causera – nous pouvons déjà l’observer – une amplification de phénomènes extrêmes comme des canicules, des inondations et des ouragans. De l’autre côté, notre mode de vie, qui détruit la nature, surexploite les ressources, pollue les milieux et bouleverse les systèmes écologiques, entraîne une disparition des espèces animales et végétales à une vitesse catastrophique. On apprenait cette année que pas moins d’un million d’espèces vivantes sont menacées d’extinction, alors que 60 % des animaux sauvages ont déjà disparu depuis 1970. Nous n’avons rien vu de tel depuis la disparition des dinosaures.
Cette situation me glace le sang. Il y a une quinzaine d’années, un philosophe australien, Glenn Albrecht, a même donné un nom à ce genre d’angoisse : solastalgie. Né de la contraction de deux mots latins qui signifient « confort » et « peine », ce néologisme traduit « la tristesse de voir sa maison brûler ».
Depuis quelques années, nous rencontrons de plus en plus de gens qui souffrent d’écoanxiété, des personnes qui craignent de perdre leur maison sur les berges du fleuve en Gaspésie, sur la Côte-Nord ou aux Îles-de-la-Madeleine en raison des côtes qui s’érodent. D’autres ont peur pour leur santé à cause des pesticides épandus dans les champs en bordure de leur résidence. Puis nous entendons des scientifiques qui, comme moi, travaillent chaque jour avec des données alarmantes sur le sort de l’humanité et sur celui de nos frères et sœurs, les plantes et les animaux. L’écoanxiété peut être légère, voire passagère, mais dans certains cas, elle devient handicapante et pointe vers des troubles anxieux plus graves.
Mince consolation bien personnelle : mon autodiagnostic me fait tomber dans la première catégorie. Une fois que cela est dit, comment pouvons nous combattre cette angoisse ? Bien sûr, nous devons nous engager à changer les choses. Je plante des arbres, je roule à vélo et je mange moins de viande qu’avant. Je trouve un réconfort dans l’action, mais il reste toujours au fond de moi une pression, un sentiment d’urgence devant l’écocide.
Ainsi, je combats mon écoanxiété en prenant des bains de nature. Quand j’ai quelques minutes à moi, je m’assois sous un arbre dans un des parcs de mon quartier ou je regarde les eaux de la rivière des Prairies filer d’ouest en est.
Ce n’est pas d’hier que nous savons que le fait de marcher en forêt, de ramer dans un canot ou d’observer les oiseaux nous détend. Ce contact avec la nature peut même devenir une médecine préventive.
Les Japonais appellent ce sentiment de bien-être en nature le shinrin-yoku, qui signifie « bain de forêt ». Comment pratiquer le shinrin-yoku ? Tout simplement, en prenant le temps d’être dans la nature et en connectant avec notre environnement. Sans performance. Sans téléphone.
Si cela peut sembler ésotérique, la science en montre les effets bien réels: diminution marquée de la durée de la convalescence chez les patients en contact avec la nature, taux d’hypertension à la baisse, moins d’épisodes d’anxiété et de dépression chez les personnes à risque, taux de glucose à la baisse chez les diabétiques, et bien d’autres. Les bénéfices sont si marqués qu’il existe aujourd’hui 44 forêts thérapeutiques au Japon et 37 en Corée du Sud, soutenues par les agences de santé publique. Assis sur mon banc, je me demande : à quand de tels « hôpitaux » au Québec ?
Mais bon, seconde petite victoire : après avoir autodiagnostiqué mon mal, je peux me prescrire le remède.
Auteur : Jérôme Dupras, collaborateur au magazine Geo Plein Air, scientifique, professeur au Département des sciences naturelles de l’UQO, membre des Cowboys Fringants et activiste.
Vous aimez ce contenu? Abonnez-vous au magazine québécois Geo Plein Air.