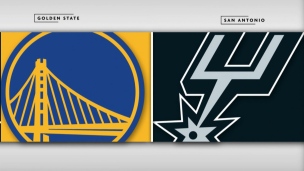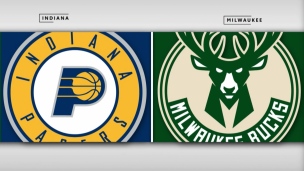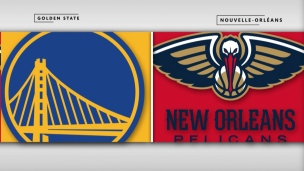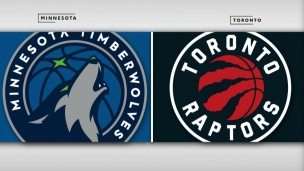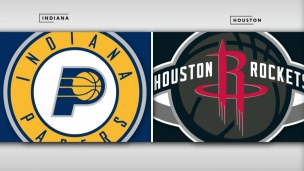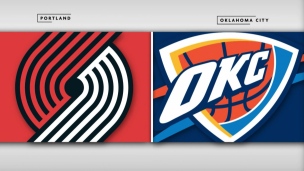Toronto, ville de basket : une incursion dans le fief des Raptors
Basketball jeudi, 11 avr. 2019. 07:00 dimanche, 24 nov. 2024. 07:59Toronto, ville de basketball! 20:37
TORONTO – C’est un vendredi soir frisquet à Toronto. À l’intersection de Bay Street et Lakeshore Boulevard, un adolescent accélère pour accorder son pas au compte à rebours d’un feu de circulation. La tuque rouge dont il est coiffé trahit sa destination, mais en vérité, il s’agit d’un rare indice de ce qui se trame de l’autre côté de la rue.
À l’intérieur de l’amphithéâtre, un beat de hip hop réchauffe les premiers arrivants. Ici, pas de Stompin’ Tom Connor ni de Nickleback. Ce sont les vers de Kendrick Lamar, Jay-Z et Drake, la vedette locale, qui enveloppent le parquet alors que les joueurs des Raptors émergent d’un sombre tunnel pour la période d’échauffement.
I’ll admit it, I’ll admit it
Rolling swishers, hittin’ swishes
Got me feelin’ like a ball hog (...)
Shit is hot up in the 6 right now
Une dizaine de minutes avant le début du match, les lumières s’éteignent. La pénombre est à peine installée qu’une gigantesque flamme surgit sous chacun des paniers au son d’une violente détonation. Au plafond, des feux d’artifice s’occupent des tympans qui auraient résisté à la première salve. Si vous étiez venus pour une petite soirée tranquille, l’heure est déjà à la révision des plans.
Au centre du court, un annonceur prend le micro pour gueuler l’alignement partant de l’équipe locale. Se succèdent alors dans une impressionnante chorégraphie de high fives le « big boss of Barcelona », Marc Gasol, le « Moneyman from three-point land », Danny Green, « Spicy-P » Pascal Siakam, « Steady » Fred VanVleet et le « Claw », Kawhi Leonard. Ce dernier s’attire les rugissements les plus nourris d’une foule qui n’en peut plus d’attendre.
Une mascotte musclée martèle un timbre métronomique sur un gong. Des danseurs s’excitent partout autour de l’aire de jeu. Le ballon est mis en jeu. Quand Siakam conclut, quelques instants plus tard, une possession née d’un bloc de Gasol avec un tir de trois points millimétré, c’est l’éruption.
Rien n’a plus de valeur qu’un billet pour les Raptors en ce début de week-end dans la Ville Reine. Mais malgré cet indéniable constat, il est difficile de se départir de l’impression que l’équipe n’est qu’une invitée dans une maison qui n’est pas la sienne. Dans les dédales du Scotiabank Arena, les murs sont peints en bleu et servent à exposer la riche histoire des autres locataires de l’édifice. On y trouve tellement de références à la coupe Stanley qu’on jurerait que 1967 représente le nombre de fois qu’elle y a été gagnée plutôt que l’année de sa dernière conquête. Au plafond est accroché le portrait de 19 anciens joueurs qui ont marqué l’histoire des Maple Leafs, de King Clancy à Turk Broda, de Frank Mahovlich à Doug Gilmour. Derrière sont immortalisées les éditions championnes de la franchise centenaire.
Entre ces deux rangées ostentatoires pendent discrètement six décorations à l’effigie des Raptors, cinq pour autant de titres de la division Atlantique qu’ils ont décrochés et une autre, symbolique, pour commémorer leur naissance en 1995.
Mais voilà, à Toronto, les visages qui ont fait grandir le basketball ne sont pas imprimés en noir et blanc sur des bannières. Ils sont dans la rue et pour saisir véritablement la place qu’occupe leur sport dans l’ADN de la métropole, il faut aller à leur rencontre.
Started from the bottom...
Akil Augustine avait 9 ans quand il est arrivé dans le « 416 » au début des années 1990. Son truc à lui, c’était le football, mais dans sa famille adoptive, la grosse affaire, c’était le basket. Le sport à cette époque s’apprenait dans la rue et c’est en accompagnant un cousin plus âgé qu’Augustine a poinçonné ses premiers points de repère sur la carte de sa nouvelle ville.
« Son équipe jouait dans des tournois dans le nord-est des États-Unis et dans l’est du Canada. C’était un petit circuit pour les joueurs les plus dévoués de Toronto, se remémore Augustine, qui est aujourd’hui animateur sur la chaîne NBA TV. J’ai été élevé dans cet environnement underground où tout le monde était un mordu de basket. On avait adopté ce sport bien avant qu’il devienne populaire ici. Les Raptors n’étaient même pas dans les plans à cette époque et dans mon entourage, personne n’attendait qu’ils existent. »
Quand son cousin a décroché un job à l’école secondaire Eastern Commerce, Augustine s’est vu ouvrir les portes d’une véritable institution. Avant l’éclosion des chics écoles préparatoires et des programmes d’élite, Eastern Commerce était ce qui ressemblait le plus à une pépinière de talent dans la région de Toronto. Augustine se souvient d’y avoir découvert les Collin Charles, Waleed Belcher, Aaron Grant et un certain Jamaal Magloire.
Ces premiers mentors étaient, comme lui, des fils d’immigrants dont l’arrivée au Canada dans les années 1970 avait été facilitée par la politique sur le multiculturalisme instaurée par le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau.
« C’est l’un des principaux facteurs qui ont mené à l’explosion du basketball ici, identifie sans hésiter Augustine. Pensez à tous ces sprinteurs qui ont représenté le Canada aux Olympiques. À plus petite échelle, le même afflux de talent a été observé dans nos gymnases. On y retrouvait soudainement des Jamaïcains qui sautaient par-dessus tout le monde et des Serbes qui pouvaient tirer de n’importe où sur le court. Le problème, c’est qu’ils ne savaient pas vraiment jouer au basketball. Princeton offense, full court press, back cut, flare cut... il n’y avait rien de tout ça dans le basketball canadien! »
 Parmi tous ces super-athlètes, Magloire a été l’exception à la règle. Recruté en 1996 par le prestigieux programme de l’Université du Kentucky, il a été un choix de première ronde des Hornets de Charlotte et a connu une carrière de 15 ans dans la NBA, une anomalie pour un joueur canadien à l’époque. Pour les autres, le rêve de continuer au niveau professionnel s’évaporait généralement de l’autre côté de la frontière.
Parmi tous ces super-athlètes, Magloire a été l’exception à la règle. Recruté en 1996 par le prestigieux programme de l’Université du Kentucky, il a été un choix de première ronde des Hornets de Charlotte et a connu une carrière de 15 ans dans la NBA, une anomalie pour un joueur canadien à l’époque. Pour les autres, le rêve de continuer au niveau professionnel s’évaporait généralement de l’autre côté de la frontière.
« Personnellement, j’ai dû tout apprendre sur le tas, témoigne Magloire. Mon parcours a été une série d’essais et d’erreurs. J’ai dû changer d’école secondaire dans l’espoir d’être vu par les bonnes personnes. L'été, je prenais l’autobus pour aller participer à des camps aux États-Unis. Les options n’étaient pas aussi nombreuses qu’aujourd’hui. »
« C’est probablement l’une des choses les plus importantes qui soient arrivées au basketball canadien, statue Augustine, parce que ces gars qui n'ont pas réussi à percer aux États-Unis ne sont pas revenus les mains vides. Ils sont revenus avec une tonne de connaissance sur les systèmes de jeu, sur les exigences requises au plus haut niveau, et ils ont commencé à s’impliquer dans leur communauté. Peu à peu, des entraîneurs qualifiés ont remplacé les enseignants bénévoles dans les gymnases de nos écoles secondaires. »
Au début des années 2000, une structure a commencé à prendre forme autour du talent local. Des camps de perfectionnement estivaux comme The Hoop Factory, mis sur pied par l’ancien capitaine de l’équipe nationale canadienne Vidal Massiah, sont apparus. Des programmes d’entraînement avancés ont vu le jour. Wayne Dawkins, un Torontois qui a joué à l’Université Eastern Michigan, a inventé l’un d’eux, Phase One. Il a aussi créé la All Canada Classic, un match d’étoiles pancanadien visant à offrir une visibilité accrue aux adolescents du pays.
Avant longtemps, le marché torontois est devenu un joueur majeur dans la production d’équipes d’élite destinées au circuit de l’Amateur Athletic Union (AAU), un réseau de tournois relevés qui ont lieu aux États-Unis au terme de l’année scolaire, d’avril à juillet. En 2008, Grassroots Canada est devenu le premier programme canadien à remporter un tournoi AAU en sol américain. Depuis, l’institution peut se targuer d’avoir collaboré au développement de Tristan Thompson, Cory Joseph et Nick Stauskas jusqu’à la NBA. Bounce, l’un de ses compétiteurs, compte Andrew Wiggins, Anthony Bennett et Tyler Ennis parmi ses anciens.
« Quand on a commencé, Anthony était en huitième année, Tyler en septième année et Andrew en sixième année, contextualise Tony McIntyre, le cofondateur de ce qui s’appelait originalement CIA Bounce. On commençait à voir qu’il y avait du gros talent dans le système, mais les tournois étaient éparpillés et c’était un peu plus difficile d’attirer les projecteurs sur nos jeunes. Puis est arrivée la EYBL, une ligue chapeautée par Nike, qui offrait soudainement une vitrine unique vers laquelle tous les yeux étaient rivés. Après des années à chercher leur voie sur les petits chemins de gravier, nos gars se retrouvaient soudainement sur l’autoroute avec la visibilité qui venait avec. »
La montée en puissance du ballon-panier au nord de la frontière a été bien documentée au cours des dernières années. Au début de la saison 2018-2019, le Canada était le deuxième plus grand producteur de joueurs de la NBA avec 13. Du groupe, dix provenaient de la région métropolitaine torontoise. Les étoiles universitaires R.J. Barrett et Nickeil Alexander-Walker, qui devraient être repêchés en première ronde en juin prochain, s’y grefferont notamment l’an prochain.
« Le talent a toujours été là, estime Magloire. Je crois simplement qu’il y a plus d’opportunités qui s’offrent aux jeunes de nos jours, ce qui est merveilleux. À leur âge, c’est ce qu’on souhaitait, c’est ce dont on rêvait, d’être comme les Américains. Et ça s’en vient. Quand j’étais dans la NBA, il n’y avait que Steve Nash, Todd MacCulloch et moi. Regardez-les maintenant! Je suis très heureux de voir où s’en va notre sport dans ce pays. »
L’arrivée des Raptors
L’implantation d’une équipe professionnelle a évidemment été un moment charnière dans la popularisation et l’acceptation du sport dans le paysage torontois.
« Les Raptors ont été plus importants que n’importe quelle autre entité dans l’élévation du basket au pays », tranche Akil Augustine, qui porte aussi le chapeau de coanimateur du balado Raptors Unpublished.
D’un sport de niche, le basketball est tombé dans l’œil du grand public avec la tentative de percée de la NBA en sol canadien. À Toronto, la proposition a fait un tabac. La marchandise à l’effigie du club a tout de suite séduit l’amateur moyen et les billets pour un match au SkyDome, le premier domicile de l’équipe, s’imprimaient par milliers. Pour leur saison inaugurale, les Raptors ont attiré une foule moyenne de 23 178 spectateurs, la troisième plus élevée de la Ligue.
 Mais une fois passé l’effet de nouveauté, la transition vers l’acceptation de la masse a atteint un plateau. Les entrées aux guichets ont diminué de près de 7000 spectateurs par match en deux ans. En 1998, les Raptors ont attiré la 18e foule en importance de la NBA. Le train sur lequel étaient arrivées ces nuées de curieux s’apprêtait à repartir vers la nouvelle saveur du moment. Puis un homme a pris le contrôle de la locomotive et l’a ramenée en gare.
Mais une fois passé l’effet de nouveauté, la transition vers l’acceptation de la masse a atteint un plateau. Les entrées aux guichets ont diminué de près de 7000 spectateurs par match en deux ans. En 1998, les Raptors ont attiré la 18e foule en importance de la NBA. Le train sur lequel étaient arrivées ces nuées de curieux s’apprêtait à repartir vers la nouvelle saveur du moment. Puis un homme a pris le contrôle de la locomotive et l’a ramenée en gare.
« Plusieurs personnes croyaient que les Raptors étaient condamnés au même sort que les Grizzlies de Vancouver avant l’arrivée de Vince Carter, indique Daniel Reynolds, le directeur du contenu du site Raptors HQ. Grâce à lui, ce scénario est devenu carrément impensable. Soudainement, la ville entière s’est mise à vibrer pour le basketball et les partisans occasionnels, ceux qui avaient toujours regardé du coin de l’œil en idolâtrant Michael Jordan, sont embarqués pour de bon. »
« Je ne peux pas penser à un autre athlète professionnel qui a, à lui seul, rallié autant de personnes derrière une équipe et un sport que Vince Carter », clame Vidal Massiah.
Comme toute chose, l’effet Carter a fait son temps. Les Raptors ont échangé leur joueur vedette dans un climat de controverse, alors qu’il était au sommet de son art, et sont retombés dans un marasme trop familier. Mais une graine avait été semée.
« L’ère Carter a cimenté une communauté, témoigne Reynolds. Le site Raptors HQ a été fondé après son départ par une poignée de partisans endurcis. Même si l’équipe était mauvaise, il n’était pas question pour ces mordus de déserter le navire. À partir du moment où un tel dévouement commence à prendre forme chez les amateurs, à partir du moment où les partisans commencent à s’approprier leur équipe de cette façon, celle-ci devient véritablement enracinée dans la culture de la ville et les performances sur le terrain deviennent superficielles. »
« Le basket est très gros ici, constate Serge Ibaka, qui joue à Toronto depuis deux ans après avoir passé les huit premières années de sa carrière à Oklahoma City et à Orlando. Ça me rappelle un peu les équipes de soccer en Europe. Tu sais comment les fans aiment leur équipe de foot là-bas? Ici, avec le basket, ça me rappelle un peu ce genre d’ambiance. Il y a de l’amour! Partout où on passe, tout le monde suit l’équipe, tout le monde parle des Raptors. Les enfants, les mamans, les vieilles... Les papas, les grands-papas... Tout le monde! »
L’impact de la présence des Raptors est visible partout dans la vie de quartier torontoise. Depuis 2006, la Fondation MLSE a investi plus d’un million de dollars dans la construction ou la réfection de onze installations extérieures. Dans la banlieue de Mississauga, les Raptors 905, une équipe de la ligue de développement de la NBA, peuvent jouer devant des foules de 5000 spectateurs. Depuis quatre ans, Nike commandite la Crown League, une compétition estivale s’étirant sur cinq fins de semaines et qui met en vedette quelques-uns des meilleurs joueurs professionnels et amateurs de la région.
Et les Torontois n’hésitent pas à afficher leurs couleurs. Depuis octobre 2018, le maillot de Kawhi Leonard est le treizième plus populaire dans les ventes enregistrées sur NBA.com.
« C’est difficile à quantifier, mais la tarte est assurément divisée différemment qu’il y a 20 ans, illustre Reynolds. J’étais à l’école secondaire en 1999, les Maple Leafs étaient en séries et je peux vous dire que tout le monde se foutait pas mal de ce que faisaient les Raptors. Mais les temps ont changé. Aujourd’hui, les Leafs aspirent à de grandes choses, mais ils n’éclipsent plus leurs voisins. Ça fait un peu penser à ce qui se passe à Boston. Ce fort sentiment de fierté qu’ont toujours suscité les Leafs n’est désormais plus réservé à une seule équipe. »
Nous, le Nord
Un nuage de vapeur s’échappe de la bouche de Haley Zhou au moment où son ballon ricoche sur l’anneau métallique qu’il avait pris pour cible. Même si la température ressentie est légèrement figée sous le point de congélation, le jeune architecte de 27 ans a décidé de substituer son jogging dominical pour venir pratiquer son tir suspendu au David Crombie Park, un court extérieur emblématique de la Ville Reine gardé par les gratte-ciel du centre-ville, à une dizaine de minutes de marche du Temple de la renommée du hockey.
 Zhou est l’incarnation même de la vague de popularité qui a soulevé le basket à des hauteurs jadis inimaginables à Toronto il y a cinq ans. Sa passion depuis que sa famille avait immigré au Canada, c’était le badminton. Le sport professionnel? Bof. Pourtant, au printemps 2014, il s’est surpris à encourager les Raptors dans leur polarisant parcours éliminatoire. Son histoire n’est pas unique. Ils sont des milliers cette année-là à avoir été séduits par l’énergie du « Jurassic Park » et à s’être sentis interpellés par ce qui allait devenir le cri identitaire d’une ville entière : We The North.
Zhou est l’incarnation même de la vague de popularité qui a soulevé le basket à des hauteurs jadis inimaginables à Toronto il y a cinq ans. Sa passion depuis que sa famille avait immigré au Canada, c’était le badminton. Le sport professionnel? Bof. Pourtant, au printemps 2014, il s’est surpris à encourager les Raptors dans leur polarisant parcours éliminatoire. Son histoire n’est pas unique. Ils sont des milliers cette année-là à avoir été séduits par l’énergie du « Jurassic Park » et à s’être sentis interpellés par ce qui allait devenir le cri identitaire d’une ville entière : We The North.
Les têtes pensantes de Maple Leaf Sports & Entertainement (MLSE), le conglomérat qui possède les Raptors, ont cogité pendant presque cinq ans sur la façon dont serait célébré le 20e anniversaire de la franchise.
« On avait mené un gros sondage, à l’échelle canadienne, pour demander aux gens ce qu’ils pensaient des Raptors, explique Shannon Hosford, la grande patronne du département marketing chez MLSE. Nous avons reçu en retour la pire réponse imaginable, c’est-à-dire l’apathie. En marketing, on espère toujours pouvoir jouer sur une connexion émotive, peu importe que cette tension soit positive ou négative. Mais là, toutes nos questions s’étaient butées à l’indifférence totale. On savait alors qu’on allait devoir frapper fort. »
Le premier coup d’éclat de son équipe fut de mousser la candidature de Toronto pour l’obtention du match des étoiles en 2016. Le deuxième fut de convaincre Drake, le plus célèbre partisan des Raptors, de prêter son image à l’événement et de devenir un ambassadeur officiel du club.
« Ça nous a apporté une crédibilité instantanée, a remarqué Hosford. On souhaitait attirer l’attention du reste de la planète sur Toronto. Cette ville est une porte d’entrée sur le monde et cet accomplissement est venu valider notre démarche. On voulait montrer qu’on pouvait être considéré non seulement comme un marché de basket, mais comme un pays de basket. »
Cette volonté d’élargir la portée globale de l’équipe s’est reflétée dans l’autre gros chantier entrepris par Hosford et ses soldats : réinventer son image de marque. Depuis leur arrivée dans la NBA, les Raptors avaient été la cible de toutes sortes de moqueries. Dans l’élaboration de leur transformation, leurs complexes sont devenus leurs plus beaux atouts.
« On a pris tous les clichés qui servent à se foutre la gueule des Canadiens et on en a fait notre badge d’honneur, explique Hosford. Oui, on vit dans un climat nordique. Non, notre marché n’est pas comme les autres. On a décidé de l’assumer avec fierté et passion et ça a touché une corde sensible. Dès son lancement, la campagne a été un succès instantané. Elle nous a mis sur la mappe à une vitesse qu’on aurait jamais pu prédire et sa popularité a pris des proportions qu’on n’aurait jamais pu prédire. »
Les succès des Raptors sur le terrain n’ont certainement pas nui, mais la folie entourant le mouvement « We The North » a eu un impact immédiat dans tous les secteurs de l’organisation. Hosford confirme l’information qui circulait à l’époque à l’effet que 4000 billets de saison supplémentaires ont été écoulés durant l’été qui a suivi. À chaque année depuis 2015, les Raptors jouent leurs matchs locaux devant l’une des cinq plus grosses foules de la NBA.
De nouveaux partenaires corporatifs se sont manifestés et l’engagement sur les réseaux sociaux a explosé. Aujourd’hui, les Raptors comptent 1,8 million d’abonnés sur Instagram, soit deux fois plus que les Leafs, et selon Hosford, leur application mobile est la deuxième plus téléchargée de la NBA derrière celle des Warriors de Golden State.
Cinq ans après son lancement, « We The North » demeure intimement lié à l’identité des Raptors. Un soir de match, le slogan est visible partout entre les quatre murs de l’aréna. En été comme en hiver, le béton de la ville en est tapissé.
« Il y a définitivement un avant et un après ‘We The North’ Pour moi, c’est un symbole aussi fort que le ‘Just do it’ de Nike, compare Akil Augustine. Sa composition grammaticalement incorrecte est un clin d’œil direct à tous ces partisans qui ne viennent peut-être pas des milieux les plus raffinés, aux immigrants, aux mauvais garçons, à cette foule urbaine si éclectique. De mémoire, c’est la première fois qu’une compagnie canadienne s’adresse de façon aussi évidente à cette tranche de la population et je le vois comme un effort volontaire de reconnaître que nous ne sommes semblables à ceux qui encouragent les Maple Leafs. Vous ne verrez personne se pointer à un match des Raptors en veston-cravate ou en manteau Eddie Bauer. Vous y verrez plutôt des gens qui ont trop longtemps été ignorés par les médias de masse dans ce pays. »
« Même s’ils ont arrêté d’en faire la promotion, ‘We The North’ est partout et ne s’en va nulle part, prédit Augustine. C’est un cri de guerre qui coule dans les veines de trop de gens ici. »
Le sport du futur
Les sièges commencent à claquer contre leur dossier alors que Russell Wesbrook enfile ses 17e et 18e points de la soirée à la ligne des lancers francs. Les Raptors, qui menaient par 13 points avec un peu plus de cinq minutes à faire au troisième quart, n’ont maintenant que 19 secondes pour rattraper un retard de 116-109. On ne peut blâmer personne de ne plus y croire.
Dans les quatre jours qui suivront, le Scotiabank Arena se remplira deux fois pour chacun de ses locataires. Aux guichets, il n’y a vraiment pas d’enfants pauvres dans la grande famille du sport torontois. Mais la réalité est ce qu’elle est : la génération qui verra le basketball supplanter le hockey dans la cité, si elle est déjà née, n’a assurément pas encore les moyens de payer.
« Toronto, c’est les Leafs, résume un peu à contrecoeur Akil Augustine. Je serai heureux quand les Raptors gagneront un championnat, mais ça ne se compare en rien à la folie qui s’emparera de cette ville quand les Leafs gagneront la coupe Stanley. Les baby boomers ne sont pas encore morts, tu sais! Si tu parles à n’importe quelle personne de plus de 50 ans qui a grandi ici, qu’elle soit blanche ou noire, elle te dira qu’elle a grandi devant le canal 6 avec Ron MacLean et Don Cherry. Dans 30 ans, ça aura changé. Les premiers souvenirs de plusieurs seront associés à Matt Devlin et Jack Armstrong. Mais pour l’instant, la majorité des gens de Toronto ont un profond attachement envers le hockey. Le buzz pour les Raptors est bien réel, mais la vérité, c’est qu’on vit dans une ville de hockey. »
 L’idée que le basketball soit le sport du futur à Toronto n’est pas farfelue aux oreilles de Daniel Reynolds, qui est lui-même la preuve vivante que les mœurs sont volatiles et que les mentalités sont faites pour évoluer.
L’idée que le basketball soit le sport du futur à Toronto n’est pas farfelue aux oreilles de Daniel Reynolds, qui est lui-même la preuve vivante que les mœurs sont volatiles et que les mentalités sont faites pour évoluer.
« Je ne crois pas que ça soit une lubie, surtout avec la tendance que la démographie semble emprunter. Le hockey a une certaine touche internationale, mais il demeure surtout intrinsèque à l’identité canadienne. Si vous arrivez d’un autre pays, il n’arrivera peut-être plus aussi haut dans votre échelle de valeurs. Le hockey fera toujours partie de notre histoire, mais si tu arrives ici à 7 ans, en 2019, qu’est-ce que ça signifie vraiment pour toi? »
« C’est un sport qui gagne des adeptes à un rythme fou et qui continuera de grandir, prédit Jamaal Magloire, dont la fondation fait la promotion du sport et des arts auprès des jeunes de quartiers défavorisés. Je crois que les gens s’identifient plus facilement aux joueurs de basket de nos jours. On ne porte pas d’équipement, ils peuvent voir notre visage, ils peuvent voir nos tatouages, ils peuvent voir nos muscles. Le sport est davantage présent sur les plateformes que les jeunes fréquentent. Ils se voient en nous et on se voit en eux. »